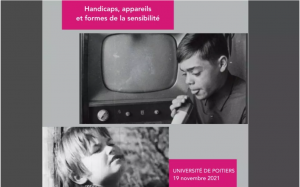Pris dans sa généralité, le terme « handicap » couvre un large spectre : troubles d’un ou de plusieurs sens, leur limitation ou leur privation (mutisme, surdité, cécité), l’hypersensibilité (auditive ou tactile par exemple). Le cinéma, en tant qu’appareil rendant sensible l’expérience de perceptions altérées, restreintes ou augmentées, discrètes ou synergiques, s’impose alors comme un instrument privilégié de découverte de sensoriums différents. La journée d’étude voudrait ainsi esquisser des pistes de réflexion pour découvrir des formes de sensibilités singulières, à la croisée entre esthétique, anthropologie et politique.
Dans le prolongement des recherches déjà entamées sur l’expérience du spectateur appareillé, nous souhaiterions poursuivre notre investigation sur les formes de la sensibilité en insistant sur les liens entre le cinéma et les handicaps sensoriels. Le terme « handicap » est en effet pris dans sa grande généralité, afin de couvrir un large spectre : les troubles ou dérèglements d’un ou plusieurs sens, leur limitation ou leur privation (mutisme, surdité, cécité), l’hypersensibilité (auditive ou tactile dans le cas de l’autisme par exemple) qui peut aller jusqu’à l’incapacité de faire monde et représentation. Comme le notait Merleau-Ponty, « l’aveugle a l’expérience d’un espace » – et les variations s’imposent d’elles-mêmes comme des évidences : le sourd a l’expérience du son, etc. À travers leur processus de différenciation historique et physiologique et au-delà des hiérarchies culturelles réglant leurs usages, les sens n’existent pas de façon isolée, et le trouble ou l’altération d’un sens permet ainsi de rendre plus évidents les liens et les échanges qui se nouent entre eux.
Dans sa grande généralité, le terme de handicap revêt toute son importance dans le monde contemporain où sont diagnostiquées de plus en plus d’atypicités neurologiques. En termes sociaux et politiques, cela rencontre l’exigence d’intégrer au monde commun des êtres « différents » et passe par la possibilité, pour les « typiques », de comprendre et de se représenter l’appréhension sensible d’autrui. Le cinéma, en rendant sensible l’expérience de perceptions altérées, restreintes ou augmentées, discrètes ou synergiques, paraît alors un instrument privilégié de découverte de sensoriums différents. Le cinéma offre en effet une médiation exemplaire qui appellent un certain nombre d’interrogations :
– en termes théoriques : de manière transcendantale, on peut questionner les moyens de production d’une altérité sensorielle, en les reliant à des facteurs historiques et techniques : capacités perceptives des techniques de prises de vue et de son (dans le sillage des philosophies de l’appareil, de Benjamin à Huyghe et Déotte), modulation et transformation de l’écoute médiatisée (champ de recherche développée par les sound studies), nouvelles interactions entre homme et machine en particulier via les interfaces numériques contemporaines (du côté de l’archéologie ou de la théorie des médias sur leur versant critique, par exemple autour du constat de l’atrophie ou de la diminution de certaines capacités gestuelles ou au contraire de nouveaux modes d’intellection).
– en termes de représentations : les films, sans spécification de genres (fictions, essais, documentaires), peuvent s’attacher à des figures souffrant de handicaps comme l’histoire du cinéma en témoigne depuis ses origines. Les approches peuvent être variées : typologie historique ou sociologique, analyse de figurations singulières (gestuelles, montage, etc.).
– en termes d’expérience : que ce soit dans la représentation explicite d’un trouble sensoriel identifié, ou de manière plus large et diffuse, on peut envisager de quelles manières des films proposent l’équivalent ou l’approximation d’une perception « autre » et questionner les effets produits. Les travaux de Raymond Bellour sur le corps du cinéma, intégrant une révision de la notion d’hypnose et une théorie des émotions, peuvent donner une impulsion de recherche en ce domaine (en particulier dans la précaution prise de ne jamais séparer la spéculation théorique d’un contact prolongé avec des œuvres) autant qu’appeler des élargissements (ne serait-ce qu’en raison du privilège de la vue). Dans le cas plus spécifique des altérations perceptives, pourrait aussi être interrogée « l’interaction entre le sensorium comme appareillage humain et les nouvelles médiations comme appareillage technique des œuvres [1] » en associant les apports des théories des appareils psychiques et perceptifs avec ceux de l’anthropologie du geste. Dans cette lignée, on pourrait reconsidérer de façon inédite des « objets » classiques des études de cinéma – par exemple, la voix off conçue comme hallucination sonore.
En tant qu’œuvres audiovisuelles s’offrant à une perception incarnée, certains films peuvent aussi jouer ou rendre apparents des passages ou relais d’un mode sensoriel à l’autre ou de possibles effets de compensation entre eux. On peut ainsi se demander comment des films se donnent à ressentir de manière synesthésique ou cénesthésique [2]. En ce domaine, les études sur la tactilité ou l’hapticité au cinéma (Jennifer Barker, Laura Marks, Vivian Sobchack) peuvent être convoquées et enrichies par de nouvelles études de cas.
Les témoignages des principaux intéressés sont par ailleurs nécessaires et devraient être sollicités : Comment des personnes affectées par un handicap sensoriel perçoivent-elles un film ? Comment penser, par exemple, le rapport littéralement appareillé au film et les continuités et différences entre médiations techniques et traductions orales (cécité) ou gestuelles (surdité) ?
Quel que soit le champ d’étude retenu ou les objets analysés, on peut d’emblée mettre en évidence un mouvement qui consiste à accuser les différences afin de permette leur reconnaissance, c’est-à-dire à la fois leur identification et leur intégration dans un monde commun rendant ces expériences transmissibles, voire poreuses.
Considérer le cinéma au prisme du handicap constitue aussi un moyen de questionnement sur des évolutions politiques et anthropologiques contemporaines qui restent inséparables de l’existence et des usages d’un certain nombre d’appareils ou dispositifs techniques. La théorie benjaminienne qui fait de l’homme moderne un appareil bombardé de perceptions et fondamentalement distrait pourrait trouver une incarnation non métaphorique dans le type d’autisme caractérisé par un « brouillage sensoriel sévère » [3]. Les influx nerveux suscités par les stimuli audio-visuels sont souvent bien plus violents à canaliser pour les autistes et mériteraient d’être étudiés à la lumière du concept d’innervation, que Benjamin réserve aux décharges motrices suscitées par les appareils (voir les travaux de Miriam Hansen, Peter Szendy ou encore Antonio Somaini sur cette notion). Les déambulations d’autistes hors langage, telles qu’elles sont données à voir dans Le Moindre geste (Fernand Deligny, 1971) sous la forme de « lignes d’erre », pourraient ainsi être envisagées comme des réponses nerveuses à l’emprise d’un film, extérieur ou intérieur, et être lues à la lumière conjointe des travaux de l’anthropologue Tim Ingold (Une brève histoire des lignes), de la « pensée cartographique des images » (Teresa Castro) et, plus généralement, des théories de la captation de trace et de l’écriture comme appareil d’enregistrement.
Par ailleurs, il serait tentant pour la théorie du cinéma de considérer à nouveaux frais l’idée, fréquente chez certains penseurs des années 1920, d’une « pensée en images » qui est l’une des modalités conceptuelles de l’autisme. Les développements de la réflexion sur l’attention (que l’on trouve par exemple chez Yves Citton) pourraient sans aucun doute offrir des points de convergence fructueux.
Une telle perspective de recherche est à l’évidence susceptible d’ouvrir de nombreuses pistes interdisciplinaires, et de les médiatiser auprès du grand public, ne serait-ce qu’à une échelle modeste, dans un désir de tisser des liens entre la recherche en arts et sciences humaines et la société.
[1] Olivier Aïm, « Benjamin (Walter) », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics [en ligne], < http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/benjamin-walter> [consulté le 17 Mars 2020].
[2] Le premier adjectif désigne une « association d’impressions venant de domaines sensoriels différents » et le second, une « sensibilité organique, émanant de l’ensemble des sensations internes, qui suscite chez l’être humain le sentiment général de son existence, indépendamment du rôle spécifique des sens ». L’anthropologie sensorielle comme les études cinématographiques d’inspiration phénoménologique peuvent guider ces investigations, de même que les travaux du neurologue Oliver Sacks, par exemple Des yeux pour entendre. Voyage au pays des sourds, tr. Christian Clerc, Paris, Le Seuil, coll. « Points-Essais », 1996.
[3] Temple Grandin, Penser en images. Et autres témoignages sur l’autisme, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 60.
Informations complémentaires